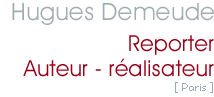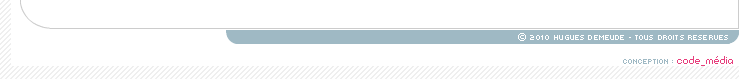CA M'INTERESSE (Extrait de l'enqu�te, janvier 2002) CA M'INTERESSE (Extrait de l'enqu�te, janvier 2002)
Transports exceptionnels : Par o� les faire passer ?
Grogne des habitants et des maires, restriction croissante des itin�raires,
tracasseries administratives� Pour les transporteurs, l'organisation d'un
convoi exceptionnel rel�ve souvent du parcours du combattant. Et les co�ts
s'envolent.
Mobiles homes, bulldozers, cuves de 250 m3 et plus, bois de grume, car�nages
d'avion, bateaux, tunneliers, g�n�rateurs de vapeur, les convois exceptionnels
offrent mille visages. La l�gislation les d�finit ainsi : tout transport
de 40 t, 16,5 m de long ou 2,5 m de large. Or, ces g�ants qui atteignent
parfois 500 t souvent mal-aim�s. "En France, on consid�re qu'ils sont
perturbateurs, voire dangereux, et qu'il faut donc les �carter des grandes
voies", constate Thierry Costard, PDG de la Scal�s, leader du secteur.
"Nos voisins ont un raisonnement diff�rent. Pour eux, il convient de
faire passer ces convois le plus vite possible. En Allemagne, ils prennent
l'autoroute de nuit, avec une vitesse minimale impos�e pour s'int�grer
dans le trafic." En France, au contraire, les autoroutes leur sont interdites.
Motif invoqu� par les pouvoirs publics : la s�curit�, � cause de leur
trop faible vitesse.
Un autre sp�cialiste du secteur ajoute : "De tous les itin�raires ayant
des ouvrages d'art, sur lesquels pouvaient passer, il y a quelques ann�es,
des convois de 180 t, voire interdits. Par exemple, le pont de l'Ouv�ze
sur la RN7, interdit en 1999 aux transports exceptionnels par le maire
de Sorgues (Vaucluse), se trouve sur un itin�raire tr�s important pour
les convois de plus de 120 t, D�sormais, on est oblig� de mettre le "colis"
sur une barge � Lyon et de le ressortir � Marseille. Cela co�te
beaucoup plus cher."
Autre probl�me : la r�volte d'un nombre croissant d'�lus locaux. "Nous
allons am�nager le centre de notre commune de mani�re qu'il devienne un
obstacle infranchissable pour les convois", annonce Alain Feugier, premier
adjoint de la-Tour-Salvagny (Rh�ne), commune situ�e sur un itin�raire
incontournable pour les transports exceptionnels. "Nous allons r�duire
la chauss�e � sa plus simple expression et renforcer les ronds-points".
Jean-Paul Delevoye, pr�sident de l'association des maires de France,
temp�re : "Aucun maire, � ce jour, ne s'est durablement oppos� � leur
transit." Une fa�on de reconna�tre, a contrario, que les blocages occasionnels
se multiplient ! "Les maires n'essaient pas d'emp�cher le passage des
convois exceptionnels dans leurs communes, mais de les s�curiser" estime-t-il.
Alors, comment concilier rar�faction des itin�raires et hausse r�guli�re
de ces transports hors normes ?" Depuis dix ans, les clients demandent
de plus en plus des pi�ces pr�-assembl�es", explique Fran�ois Rebisky,
directeur des achats de BSL, entreprise sp�cialis�e en chaudrennerie.
"Con�ue sur un site, une pi�ce co�te beaucoup plus cher que si elle est
fabriqu�e en atelier." Il faut donc souvent transporter des colonnes
de 50 m de long pour 5 m de diam�tre, des moteurs thermiques de 500 t,
des cuves de 200 t, ou des colis larges de 6 m ! Chaque semaine, un sp�cialiste
comme la Scal�s achemine environ 6 chargements de plus de 100 t. Mais
qui d�cide des itin�raires autoris�s ? "Leur carte est �tablie apr�s
consultation des services de voirie, qui, localement, d�signent les trajets
les mieux adapt�s", pr�cise Jean-Louis Mignard, charg� du bureau de la
s�curit� � la Direction de la s�curit� et de la circulation routi�re (DSCR).
"La r�glementation institue un r�gime d'autorisation pr�fectorale, proche
du terrain, qui permet de g�rer au mieux les contraintes." Le pr�fet
de chaque d�partement est charg� d'organiser une concertation locale.
Sous son autorit�, les agents de la Direction d�partementale de l'�quipement
(DDE) rappellent aux �lus qu'ils doivent comprendre l'int�r�t de conserver
une chauss�e de 6 m de large. Cependant, ils n'ont pas d'argument juridique
� leur opposer : aucune jurisprudence administrative n'existe sur la circulation
des transports exceptionnels, comme c'est le cas pour les poids lourds
classiques.
Ce syst�me d�centralis� se traduit par d'importantes diff�rences entre
les d�partements. Certains sp�cialistes de montages de dossiers t�moignent
: "Quelques d�partements frontaliers g�rent beaucoup de dossiers et sont
parfois rigides sur leur recevabilit�. M�me si un dossier est complet,
on n'obtient jamais d'autorisation avant quatre, voire six semaines. Globalement,
il y a plus de bonnes relations que de mauvaises, mais quelques d�partements
bloquent. Et comme on est tenu d'avoir l'avis de chacun des d�partements
travers�s, cela peut tr�s rapidement se gripper. Si vous allez de Marseille
� Lille, il faut que les 17 ou 18 d�partements travers�s donnent leur
accord !" Dans certains cas, la lenteur de la d�livrance des autorisations
de circuler par les agents de la DDE peut rendre tr�s difficile l'organisation
d'un transport, Cela oblige les industriels � avoir une planification
tr�s pr�cise pour respecter des dates : si un convoi prend un, deux ou
trois jours de retard, le bateau vers lequel est achemin� la cargaison
n'attend pas gratuitement� Cela peut vite co�ter cher�
Toutefois, un r�cent arr�t� interminist�riel, qui fixe les modalit�s d'application
du d�cret du 21 d�cembre 2000, va instituer une plus grande homog�n�it�
des proc�dures, ainsi que des sanctions plus s�v�res contre les transporteurs
ne respectant pas les autorisations (jusqu'� 3 050 euros d'amende en cas
de r�cidive). Sans doute permettront-elles de combler le d�ficit de communication
entre les professionnels du transport et l'administration. Mais le dialogue
avec les �lus locaux et les habitants reste, quant � lui, aux abonn�s
absents.
Hugues Demeude
|