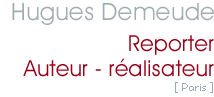Les Alphabets Animés (L'Aventurine, et Thames & Hudson, janvier 1996) Les Alphabets Animés (L'Aventurine, et Thames & Hudson, janvier 1996)
- Extrait de l'ouvrage -
 La magie des lettres animées
La magie des lettres animées
"C'est de l� que nous vient cet art ing�nieux de peindre la parole
et de parler aux yeux, et par des traits divers de figures trac�es, donner
de la couleur et du corps aux pens�es."
Lucain, po�te du premier si�cle de notre �re, commente dans ce passage
du po�me �pique inachev� la Pharsale, l'origine ph�nicienne de l'alphabet.
Syst�me � part enti�re, invent�, cod�, transmis puis stylis�, l'alphabet
est un myst�re qu'on ne cesse d'oublier. D'abord anonn�es, puis assimil�es,
les lettres qui le composent sont bien vite si famili�res qu'elles en
perdent leur secr�te richesse. A force d'�tre utilis�s, les mots sont
vid�s de leur substance, les lettres perdent leur attrait.
Et pourtant, ce sont bien ces lettres qui rendent possible l'�criture,
la lecture et l'�nonciation de la pens�e. Elles condensent � elles seules
toute l'exp�rience humaine. Un grand amoureux de la langue et des mots,
Victor Hugo, nous le rappelle : " la soci�t� humaine, le monde, l'homme
tout entier est dans l'alphabet. La ma�onnerie, l'astronomie, la philosophie,
toutes les sciences ont l� leur point de d�part, imperceptible, mais r�el.
L'alphabet est une source. "
Une source et un myst�re qui ont inspir� de nombreux artistes, � commencer
par les artistes calligraphes, peintres et graveurs. Des artistes qui
se sont avant tout pr�occup�s du trac�, du caract�re graphique et de la
qualit� plastique des lettres qui composent l'alphabet. Hugo de poursuivre
: " Tout ce qui est dans la langue d�motique y a �t� vers� par la langue
hi�ratique. L'hi�roglyphe est la racine n�cessaire du caract�re. Toutes
les lettres ont d'abord �t� des signes et tous les signes ont d'abord
�t� des images. " Avant que d'�tre porteur de sens, loin d'�tre r�duite
� un simple signe usuel, la lettre est le berceau de l'imagination, le
support de toutes les fantaisies.
Au fil du temps, comme au fil des textes, l'�criture s'est modifi�e, s'est
transform�e comme nous allons le voir, en vertu de principes historiquement
d�termin�s, qui lui ont servi de vecteurs. Avec ces changements de peau
successifs, et � partir d'eux, les artistes n'ont eu de cesse de magnifier
les lettres. Ils les ont anim�es en les ornant, drapant et peignant. Ils
leur ont donn� vie en leur pr�tant chair humaine et corps animal. Ils
les ont glorifi�es en leur restituant toute leur puissance �vocatrice.
Chacun peut se ressourcer au contact de ces lettres magiques, car pour
tous celles-ci proposent un voyage au coeur d'un monde d�sint�ress� et
ing�nu. C'est en quelque sorte celui de l'enfance, celui o� le mot n'a
pas encore prise sur la lettre. Dans ce monde, la lettre est une invitation
aux r�ves, une promesse de songes inou�s.
L'art de l'�criture
Les romains de l'�poque classique assimilent et transforment cet h�ritage
de l'alphabet qu'ils recoivent des ph�niciens � travers les Grecs et les
Etrusques. Le t�moignage que nous en avons provient notamment de papyrus
o� l'on retrouve l'�criture romaine de cette �poque faite � l'encre. Ces
papyrus, plantes des bords du Nil qui donneront beaucoup plus tard le
nom papier � l'un des supports de manusrits qui leur succ�deront, �taient
recouvert d'inscriptions en majuscules. Les lettres minuscules n'existaient
pas encore, m�me si certaines de ces lettres capitales �taient encore
plus grandes et plus voyantes que d'autres. Ces capitales, dont l'�thymologie
renvoie � ce qui est en t�te de chap�tres, sont bien ordonn�es, anguleuses
et charpent�es. Mais cette �criture romaine classique va s'enrichir, au
d�but de l'�re chr�tienne, de deux nouveaux alphabets. La lettre minuscule
cursive et l'onciale apparaissent. Ces deux alphabets permettent d'all�ger
l'�criture, de la rendre plus souple. Ces deux formes d'�criture donnent
bien le sentiment de courrir sur le parchemin (d'o� le nom d'�criture
cursive), mais l'onciale, plus stricte et moins fluide que l'�criture
romaine commune, n'aura pas une influence aussi forte que celle-ci. M�me
si ce que nous avons l'habitude d'appeler "caract�re romain d'imprimerie"
ne nous arrive pas directement de cet alphabet, il n'en reste pas moins
que ces lettres minuscules romaines ont �t� un puissant ferment de notre
civilisation. L'invention du livre, en tant qu'objet rassemblant des pages
feuilletables et agencement de textes mis en valeur, a permis d'en garder
la trace.
A l'aube du Moyen Age, le papyrus f�t remplac� par le manuscrit. Ce nouveau
livre, dont le support est � base de peaux d'animaux pr�par�es, est �
la fois maniable, peut comporter un grand nombre de pages, et se conserver
longtemps. Apr�s les invasions conqu�rantes des barbares, qui int�grent
l'�criture romaine sans lui faire b�n�ficier d'apports m�morables, la
renaissance de la pratique religieuse � partir du VI�me si�cle favorise
le renouveau de la chose �crite. Cela co�ncide d'une part avec le mouvement
des premiers missionnaires qui vont �vang�liser les tribus pa�ennes du
nord de l'Europe. Pour se faire entendre, ils leur montrent en effet une
bible et la lise, en signe et pour preuve de la r�v�lation �crite. D'autre
part et plus profond�ment, les exemples de St J�r�me, p�re de l'�glise
latine qui consacra son activit� aux �tudes bibliques, et de St Beno�t,
fondateur de l'ordre b�n�dictin qui exigea la pr�sence d'une biblioth�que
dans chaque monast�re, indiquent la voie du nouvel id�al monastique. Dans
les monast�res et les couvents, les salles d'�critures (scriptrium) se
remplissent de calligraphes (scriptores). L'�criture et la mise en valeur
des manuscrits, appel�s en l'occurrence codices (codex au singulier),
devient en effet � cette �poque, et ce jusqu'au XII�me si�cle, le monopole
des moines. Durant cette p�riode, des milliers de splendides manuscrits,
r�clamant un travail consid�rable, vont ainsi �tre r�alis�s dans toute
l'Europe. En Irlande et en Angleterre, en Allemagne, en Italie et en France,
les diff�rents monast�res rivalisent en assiduit�, en ing�niosit� pour
am�liorer l'art de l'�criture et l'embellissement du livre. Toutes ces
�coles recherchent en effet � se perfectionner dans la pratique calligraphique.
Le bon calligraphe ne fait pas que recopier des livres. Il essaie pl�tot
de trouver quelle est la lettre et le style d'�criture qui convient le
mieux au type de livre qu'il recopie. Il s'efforce de rendre visible la
parole du Christ de la fa�on la plus judicieuse. Ces recherches vont �tre
couronner de succ�s sous le r�gne de l'Empereur d'Occident Charlemagne
qui introduit, au d�but du IX�me si�cle, ce qu'il est convenu d'appeler
la r�forme carolingienne. Pour Charlemagne, lui m�me fin lettr�, les livres
deviennent de v�ritables joyaux. Il souhaite que la production de codices
s'accroisse et se r�pande, mais que celle-ci se fasse avec une �criture
plus usuelle et plus lisible. C'est ainsi qu'appara�t la lettre minuscule
caroline. Menue, ronde, facile � �crire et agr�able � lire, cet alphabet
minuscule, qui s'inspire de l'�criture romaine commune, se diffuse dans
tous les monast�res et toutes les abbayes de la France carolingienne.
Charlemagne montre l'exemple et prend l'habitude de commander des manuscrits
richement d�cor�s et tr�s pr�cieux. Les grands monast�res qui produisent
ces livres sont ceux de Tours, Reims, Saint Denis ou encore Saint M�dart.
Ce choix d'�criture est d'autant plus important qu'il a marqu� le Moyen
Age, a �t� repris par les humanistes de la Renaissance, et nous a �t�
transmis � travers le caract�re d'imprimerie dit "romain", qu'il faudrait
en fait appeler "caroline".
La mue des lettres
La minuscule caroline s'est donc diffus�e avec et � travers les livres
religieux, les livres classiques et les documents, que copiaient inlassablement
les moines. Mais cette production vaste et vari�e de livres par les eccl�siastiques
a commenc� de se ralentir au XII�me si�cle avant de prendre fin le si�cle
suivant. En fait c'est leur monopole de production qui a disparu. Au cours
du XII�me si�cle, la culture et la curiosit� intellectuelle se r�pandent
dans le monde la�c. On veut lire les classiques, apprendre le latin et
le grec. Peu � peu des centres intellectuels s�culiers se regroupent pour
finalement donner vie aux universit�s. Bologne dans la seconde moiti�
de ce si�cle, Paris au d�but du suivant, deviennent des centres d'�tudes
tr�s r�put�s. Ce besoin et cette demande de livres devient un v�ritable
commerce qui d�bouche sur la professionnalisation du calligraphe et la
cr�ation du m�tier de libraire. Peu � peu, sur une centaine d'ann�es,
ces nouveaux scribores modifient l'�criture des codices. La lettre minuscule
caroline se transforme en une lettre anguleuse, haute, s�che, plut�t artificielle.
C'est l'�criture gothique. Elle prend son essor dans le monde chr�tien
et marque de son empreinte la fin du Moyen Age. Elle correspond � son
temps et co�ncide avec l'�dification des cath�drales gothiques et l'�mergence
de la bourgeoisie.
A partir du XII�me si�cle, le clerg� ne ma�trise plus le style de l'�criture,
qu'il s'agisse de l'alphabet monumental ou de la graphie des lettres.
La bourgeoisie �mergente, le commerce et l'enrichissement aidant, veut
du nouveau et aspire � un certain luxe. Les livres sont d'autant plus
recherch�s qu'ils ont une �criture luxueuse et sophistiqu�e. Par un ph�nom�ne
de mim�tisme, on retrouve dans cette �criture les m�mes lignes bris�es,
les m�mes �quilibres suspendus que dans les c�l�bres monuments de cette
�poque.
Cette �criture gothique, aussi �l�gante qu'elle ait pu �tre dans ses r�alisations
les plus heureuses, n'a pas �t� appr�ci�e par les humanistes de la Renaissance.
Ils lui pr�f�r�rent, en recherchant dans les biblioth�ques, l'ancienne
lettre minuscule caroline. Mais, pr�occup�s qu'ils �taient par le monde
classique, ils crurent qu'elle provenait de l'ancien alphabet romain,
et �tait � ce titre le reflet de la grande civilisation classique. C'est
depuis Florence, au XV�me si�cle, que va se propager cette nouvelle r�forme
de l'�criture. Elle va d'ailleurs se diffuser loin dans le temps et l'espace,
car c'est elle qui formera en d�finitive les caract�res mobiles d'imprimerie.
Pour Victor Hugo dans Notre Dame de Paris, " L'invention de l'imprimerie
est le plus grand �v�nement de l'histoire. C'est la r�volution m�re. C'est
le mode d'expression de l'humanit� qui se renouvelle totalement, c'est
la pens�e humaine qui d�pouille une forme et en rev�t une autre, c'est
le complet et d�finitif changement de peau de ce serpent symbolique qui,
depuis Adam, repr�sente l'intelligence.
"Ce nouveau mode d'expression, m�me s'il ach�ve un cycle, permettra de
garder en m�moire et de propager un art illustre d�j� tr�s pr�sent dans
les manuscrits, et qui correspond bien au serpent symbolique qu'�voque
Hugo : l'art de mettre la lettre en lumi�re.
Hugues Demeude
|